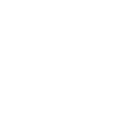L’actuel président de l’Association des maires de France (AMF), David Lisnard, a été le collaborateurde l’ancien, Jacques Pélissard, à Lons-le-Saunier. Ensemble, ils reviennent sur la création de l’AgenceFrance locale (AFL), qui fête ses dix ans, et évoquent l’accès aux financements pour les collectivitésdans un contexte toujours plus contraint.
L’Agence France locale (AFL) fête cette année ses dix ans. Comment est née l’idée d’une banque détenue par les collectivités ?
Jacques Pélissard : En 2008, en raison de la crise des subprimes et des difficultés de Dexia, les collectivités locales avaient du mal à emprunter, avec une tension forte sur le financement des investissements. J’ai retenu la démarche novatrice de l’Association des communautés urbaines de France, qui avait lancé deux emprunts, en 2004 et en 2007, pour faire appel directement aux marchés financiers. J’ai contacté Gérard Collomb, alors président de l’association, et Michel Destot, président de l’Association des grandes villes de France. Ils faisaient face aux mêmes contraintes financières. Mais Bercy ne nous a pas aidés, c’est le moins qu’on puisse dire ! Il était occupé à gérer les emprunts toxiques et à reconstituer un pôle sur les cendres de Dexia. Le ministère montrait donc une forte réticence à l’encontre de l’Agence France locale, qui pouvait faire concurrence à ce pôle restructuré. Nicolas Sarkozy et François Baroin, alors ministre de l’Economie, étaient tétanisés par le fait que l’on puisse faire appel à la garantie de l’Etat, alors que nous voulions créer une structure de collectivités indépendante de l’Etat. Il n’était pas question que l’on lui demande sa garantie !
David Lisnard : Depuis 2015, ma communauté d’agglomération (la communauté d’agglomération de Cannes pays de Lérins, ndlr), dont j’ai la responsabilité, est adhérente et actionnaire. On a vu l’opportunité d’obtenir un véhicule financier permettant à la fois d’être indépendant de l’Etat et de ne pas dépendre des soubresauts du marché. Je précise que je n’ai aucune considération affective lorsque je souscris à des emprunts. Je prends ce qu’il y a de plus performant. Et la performance c’est le taux, mais aussi le montant et la réactivité. Car l’emprunt n’est pas que de la technique financière, c’est aussi la capacité de concrétiser un projet de mandat, donc de faire vivre la démocratie locale.
Quel bilan faut-il tirer de cette décennie passée ?
J. P. : D’abord, toutes les collectivités devaient pouvoir être adhérentes. Pour l’AMF, qui veille à l’égalité de traitement de toutes les collectivités, à risque égal, les taux sont les mêmes, quelle que soit la commune. On a aussi développé la réactivité de l’AFL avec une expertise sur plusieurs sujets autour de la transition écologique. Ensuite, on s’est inscrit dans une démarche de développement durable, mais on a refusé les prêts verts. Ce n’est pas à une banque de sérier les prêts en fonction des objectifs définis par un tiers. C’est la commune qui décide d’emprunter et d’affecter son prêt.
D. L. : L’AFL a pour mandat exclusif de prêter aux collectivités, ce qui est, pour elles, une source de sécurité supplémentaire. Les prêts verts se font forcément au détriment d’autres financements et c’est aux élus de décider des priorités, pas à l’organisme prêteur ni à l’Etat.
Certaines collectivités rencontrent actuellement des difficultés à emprunter…
D. L. : On retrouve, depuis quelques mois, un renchérissement du coût du crédit et une raréfaction de l’offre bancaire. Et nous ne sommes qu’au début de la crise des taux, parce que, s’ils n’augmentent quasiment plus, l’inflation devrait de son côté reculer, maintenant ainsi les taux réels très élevés. Le contexte actuel a donc des points communs avec ce que l’on a affronté au milieu des années 2000.
Aujourd’hui, quel est l’enjeu financier principal ?
D. L. : Rien qu’en matière de transition écologique, le besoin annuel d’investissement se situerait entre 12 milliards et 20 milliards d’euros, selon les sources. Aujourd’hui, on est autour de 7 milliards d’euros par an. Nous en sommes très loin, y compris l’Etat avec son fonds vert. L’enjeu est bien d’accélérer les investissements, donc de faciliter l’accès au financement, qui est actuellement très verrouillé, et de préserver la capacité d’autofinancement des collectivités territoriales.
Comment jugez-vous le niveau d’épargne des collectivités ?
J. P. : Le niveau d’endettement équivaut à quatre années et demie de leurs recettes de fonctionnement. Bercy s’inquiète à partir de douze ans. Elles ont donc une marge pour emprunter.
D. L. : On observe une baisse de l’épargne nette, avec un effet de ciseau pour les départements, qui arrive aussi dans les communes. Nous n’avons pas retrouvé le niveau d’investissement d’avant-Covid, alors que nous sommes sur la deuxième partie de mandat, celle où se concrétise le plus de crédits de paiement dans le cycle des mandats. Je rappelle que la dépense totale des collectivités territoriales françaises représente 11,4 % du PIB, là où la moyenne européenne est près de 18 %. Donc le volume de la dépense globale des collectivités est inférieur aux standards européens. En revanche, nous représentons 70% des investissements publics. Cela interroge, lorsqu’on a conscience de ces chiffres. Le fait que la DGF soit devenue une des principales ressources des communes et qu’elle diminue pour 40 % des communes sur 2024 au regard du projet de loi de finances, c’est un souci. Donc, dans la réalité financière, les collectivités territoriales ne sont pas le problème des comptes publics de la France. Il vient des comptes de l’Etat et des comptes sociaux. Et les excédents des collectivités qui sont d’ailleurs en train de plonger de 4 milliards à 1 milliard pour le bloc communal vont en déduction du déficit de l’Etat lorsque les comptes sont présentés à Bruxelles alors que la dette des collectivités ne représente que 9 % du PIB sur un total de plus de 110 % du PIB. De plus, la dette des collectivités ne porte que sur des actifs, sur les investissements, en vertu de la règle d’or. C’est un élément fondamental à comprendre. Aujourd’hui, il y a un besoin de financement. Il faut y répondre par l’emprunt, peut être en revoyant les durées de remboursement ou en établissant une critérisation pour assouplir les conditions dans le temps et dégager ainsi rapidement plusieurs dizaines de milliards de capacité de financement. Tous ces éléments jouent sur l’autofinancement. Mais celui-ci dépend d’abord des dépenses de fonctionnement. Or, au moment où on nous dit dans le projet de loi de finances qu’il faut être en dessous de 0,5 % de l’évolution de la trajectoire des dépenses publiques, le gouvernement annonce un plan école. Nous allons devoir le porter. Il annonce aussi la réintégration des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) dans les dépenses de fonctionnement, qu’il faudrait mettre des gardiens dans les écoles, etc. L’injonction contradictoire a ses limites.
Certains débats ne semblent pas avoir évolué depuis dix ans…
J. P. : Je me souviens que le Comité des finances locales parlait déjà d’étouffement en 2011, quand François Fillon décidait de geler la dotation globale de fonctionnement (DGF) ! Outre ce combat sur la DGF se pose la question des impôts : après avoir guerroyé contre la réforme de la taxe professionnelle à l’époque, nous avions réussi à préserver le produit fiscal pour les communes, mais les départements avaient en revanche trinqué. L’autre question récurrente est celle des bases locatives. Aujourd’hui, il n’y a plus de taxe d’habitation parce qu’il a été plus facile de la supprimer et de la remplacer par une dotation, via la TVA en particulier, plutôt que de réviser les bases. Les communes n’ont plus que le foncier bâti. C’est un peu court en termes d’autonomie financière. Alors je dirais que, derrière certaines constantes, il existe une aggravation de la situation financière des collectivités locales.
D. L. : Nous subissons une recentralisation fiscale après la disparition de la taxe professionnelle, de la taxe d’habitation et de la cotisation sur la valeur ajoutée. On nous met sous perfusion, il y a bien une régression de l’autonomie financière. Cette recentralisation se ressent jusque dans les appels à projets qui nécessitent une ingénierie dont disposent seulement les grandes entités. Aussi, malgré une situation financière favorable, beaucoup de communes se retrouvent ainsi dans une incapacité matérielle d’investir et d’exécuter leurs projets de mandat.
L’AMF est-elle favorable à la création d’un impôt local ?
D. L. : Oui. Nous portons l’idée de la responsabilité locale. En tant que maire, je veux rendre des comptes à mes habitants. Je veux être incité à la sobriété fiscale, donc lever l’impôt. La concentration de l’effort fiscal sur les propriétaires est profondément injuste. Elle crée des tensions entre les habitants. Quand une commune n’a plus du tout de DGF, cela veut dire que le financement repose exclusivement sur les propriétaires. Sans jouer à se faire peur pour rien, on peut parler d’étouffement des ressources locales, mais ce n’est pas seulement financier. Cela vient aussi d’une inflation exponentielle des normes. Cette réalité amplifie la distorsion entre des collectivités qui peuvent trouver les compétences pour gérer ces normes et d’autres qui n’en sont pas capables.
Mais Bercy propose de travailler sur les normes pour réaliser des économies ?
D. L. : Comme j’ai une certaine expérience de la vie, dès que j’entends parler de choc de simplification, je sais qu’à la fin, ce sera plus compliqué. Je remarque qu’avant le congrès des maires (qui se tient du 21 au 23 novembre, à Paris, ndlr), nous sommes l’objet de beaucoup d’amabilités, que nous acceptons avec grand plaisir.
J. P. : Malgré la mise en place d’un conseil d’évaluation des normes, leur masse et leur coût n’ont pas diminué. Je pense que si on doit un jour diminuer les normes, il faut un transfert des compétences de façon à ce que la norme s’adapte à la réalité locale. Tant que la norme est nationale, elle sera coûteuse et déconnectée du terrain.
Pourquoi les collectivités locales devraient-elles être les seules à voir leur ressource principale, la DGF, indexée sur l’inflation ?
D. L. : Il faut savoir à quoi correspond la DGF : ce n’est pas du revenu, ce n’est pas de la croissance. On ne peut pas, d’un côté, avoir transféré des responsabilités à travers la loi de décentralisation et supprimé des ressources locales et, de l’autre, ne pas garantir leur compensation en euros constants. C’était l’engagement de l’Etat. Jusque dans les années 2000, la question ne se posait même pas ! Ce discours est pernicieux et parfois empreint d’un populisme mondain de la part de Bercy qui consiste à dire « vous devez participer à l’effort de redressement ». Mais les collectivités le font tous les jours ! Donc le fait de ne pas indexer la DGF, c’est un prélèvement de l’Etat : quand l’année dernière l’Etat augmente la DGF de 320 millions alors qu’avec l’indexationelle aurait dû augmenter de 890 millions, l’Etat prélève en fait plus de 550 millions. L’Etat s’exonère des efforts qu’il demande aux autres. C’est ce qui agace beaucoup. La performance ne vient que de la responsabilité. Et ce n’est pas en asséchant les collectivités qu’on aura de la performance.
On parle de marché bancaire pour se financer, mais aussi de mécénat, de tiers-financements, de fonds d’investissement…
D. L. : Toutes ces sources sont pertinentes. Mais elles sont marginales dans les besoins. Le tiers-financement peut être intéressant lorsqu’il est bien conçu, quand il ne s’agit pas de partenariat public-privé qui est une façon de faire du hors-bilan dans l’immédiat, mais de plomber les dépenses de fonctionnement pour plusieurs décennies.
Les budgets verts pour les collectivités ont intégré le PLF pour 2024. Qu’en pensez-vous ?
D. L. : On veut nous imposer des budgets verts. Ces thèmes font partie de la totalité du budget et les citoyens sont des adultes qui doivent évaluer leurs exécutifs locaux sur le respect des engagements environnementaux choisis par les citoyens.
J. P. : Quand sont sortis les contrats de performance énergétique, j’ai insisté pour que toute la partie investissement soit assurée par la ville. Le fonctionnement pouvait être assuré dans le cadre du contrat performance énergétique par les paiements de fonctionnement mais l’investissement a été public.
Quel regard portez-vous sur les dix ans qui se sont écoulés pour les collectivités ?
J. P. : J’ai vu plusieurs changements. Il y a aujourd’hui de la part de la population, de groupes de personnes, des réseaux sociaux – qui à l’époque n’existaient pas – une pression considérable sur les maires. Il y a quelques années, un maire giflé, on en parlait pendant un an ! Aujourd’hui, c’est un phénomène qui peut être beaucoup plus fréquent. Donc la pression sociale a changé. Mais la perception de L’État par les collectivités, elle, n’a pas changé depuis des années. L’AMF a toujours demandé à l’Etat de faire confiance aux collectivités, d’être des coproducteurs des réglementations. Nous ne sommes pas là pour appliquer ce qu’il décide, mais pour décider ensemble. Ceci n’a pas changé. Moi j’admire beaucoup David parce qu’il arrive à piloter une structure belle et puissante qui est l’association des maires de France dans un contexte qui, à mon sens, est plus tendu socialement et financièrement, et par rapport à l’Etat qu’il y a quelques années.
D. L. : Nous sommes face aux défis environnementaux et numériques. La révolution de l’intelligence artificielle n’en est qu’à ses débuts, mais elle va tout balayer, pour le meilleur et pour le pire contre le cancer, la sécurité, la logistique urbaine, mais aussi pour le pire, c’est-à-dire une possibilité de restriction des libertés et du rôle de l’humain dans la société. C’est un défi fantastique, y compris à l’échelle locale. Parallèlement, nous vivons une crise démocratique : taux d’abstention record, violences envers les élus – en un an + 32 % – polarisation très dure qui catalogue de suite et rend difficile un raisonnement équilibré. Le fait que dans les sondages, les 18-34 ans mettent sur le même plan les démocraties, les régimes illibéraux et les dictatures. Cette crise se caractérise aussi par l’impuissance publique, avec de plus en plus de dépenses publiques, des fonctionnaires moins bien payés qu’ailleurs. La seule façon d’en sortir est de faire appel à la subsidiarité, à la responsabilité locale. Qu’on nous donne le pouvoir réglementaire !