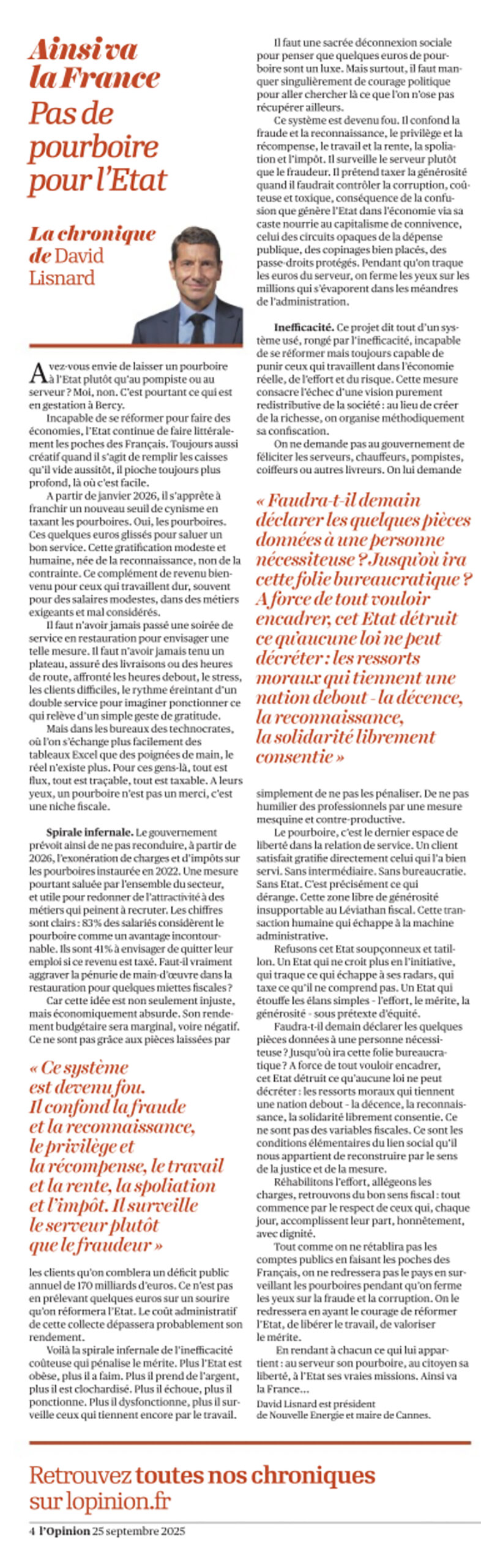Légitimité légale, légitimité politique : la difficile équation présidentielle
Combien de temps peut-on maintenir la fiction d’une autorité présidentielle quand trois Premiers ministres successifs échouent à se maintenir en l’espace de douze mois ? Retrouvez la chronique de David Lisnard pour L’Opinion.

n un an, trois Premiers ministres se sont succédé sans parvenir à gouverner. Après Michel Barnier, renversé par une motion de censure en décembre 2024, puis François Bayrou, démissionnaire en septembre 2025 après un vote de défiance, voilà Sébastien Lecornu contraint à la démission quelques heures après avoir formé son gouvernement, signant l’un des mandats les plus brefs de toute la Ve République.
Cette succession révèle un blocage profond. Le pays n’a plus de majorité parlementaire stable, aucun cap politique clair et encore moins une autorité capable d’incarner le pouvoir.
Alternative crédible. Le Président nomme des Premiers ministres qui ne peuvent pas gouverner et l’Assemblée nationale les fait tomber sans pouvoir proposer aucune alternative crédible. Pendant ce temps, les crises s’accumulent, les décisions sont reportées aux calendes grecques, la France s’affaiblit.
Cette impasse a un responsable et une origine. En changeant de Premier ministre six mois avant les élections européennes, le président de la République s’était privé de cette option au lendemain de sa défaite électorale. Quand, par erreur de jugement, par illusion sur sa capacité à maîtriser le destin politique du pays, il prend la décision irresponsable de dissoudre l’Assemblée nationale et de provoquer, dans le laps de temps le plus court autorisé par la Constitution, des élections législatives, il organise de fait un référendum sur sa propre personne.
Le résultat fut sans appel : l’Assemblée issue de ce scrutin traduit le refus des Français de lui accorder une majorité et le Président, premier responsable de la paralysie politique actuelle, traîne cette défaite depuis plus d’un an.
Face à ce constat, une question s’impose : combien de temps un Président peut-il continuer d’exercer le pouvoir quand il a perdu la capacité de gouverner ? Combien de temps peut-on maintenir la fiction d’une autorité présidentielle quand trois Premiers ministres successifs échouent à se maintenir en l’espace de douze mois ?
La légitimité légale d’Emmanuel Macron, élu pour cinq ans, est incontestable.
Esprit. Mais la légitimité d’un Président ne se résume pas à la légalité de son élection. Elle repose sur sa capacité à incarner l’unité nationale, à rassembler une majorité, à gouverner efficacement. En un mot, elle repose sur la légitimité qu’il tire du peuple. C’est l’esprit de la Ve République.
Or, depuis la dissolution de juin 2024, cette légitimité politique s’est évaporée.
Il est de bon ton, aujourd’hui, d’accuser nos institutions. Certains réclament une VIe République. Ils veulent réformer le mode de scrutin, introduire la proportionnelle intégrale, affaiblir l’exécutif, renforcer le Parlement. Ils croient que le problème vient de l’architecture constitutionnelle et que modifier les règles du jeu suffira à restaurer la gouvernabilité.
C’est une erreur. Les institutions de la Ve République sont solides. Elles ont prouvé leur résilience depuis 1958. Elles ont traversé les crises, les alternances, les cohabitations. Elles ne sont pas responsables de notre situation actuelle.
La stabilité politique de 1958 ne provenait pas uniquement des institutions elles-mêmes, mais du leadership de De Gaulle et de la force qu’il tirait du peuple. D’abord par le référendum de 1958, ensuite par l’élection du président de la République au suffrage universel direct, car les institutions valent aussi par la légitimité de celui qui les incarne.
Autorité. Elles ne fonctionnent que si le Président dispose de l’autorité nécessaire pour diriger le pays, constituer une majorité capable de le faire, ou accepter une cohabitation qui permette au gouvernement de gouverner.
Lorsque cette autorité manque, s’accrocher au pouvoir ne préserve pas les institutions. Cela les affaiblit, les expose et les discrédite.
Quand il perd de peu le référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat en avril 1969, le général de Gaulle décide sur le champ de cesser d’exercer ses fonctions de président de la République. Rien ne l’y obligeait. Sa légitimité légale n’était évidemment pas contestée et sa légitimité politique avait été renforcée moins d’un an plus tôt à l’issue d’élections législatives largement victorieuses.
Mais parce qu’il estimait ne plus avoir la confiance du peuple, parce qu’il considérait que la légitimité politique ne se décrète pas, parce qu’il savait que rien n’est au-dessus du peuple, il choisit de démissionner.
Souveraineté populaire. Ce geste n’a pas affaibli les institutions. Au contraire. Il a montré que la Ve République n’était pas un régime personnel, mais un système fondé sur la souveraineté populaire. Qui oserait reprocher au Général d’avoir trahi l’esprit de la Constitution en démissionnant ? Personne. Au contraire : il a incarné ce que la fonction présidentielle a de plus noble : la responsabilité devant la Nation.
Il ne s’agit pas de réclamer la démission d’Emmanuel Macron comme le fait l’extrême gauche, qui cède à ses vieux réflexes factieux, mais de lui demander d’avoir une conception assez exigeante du mandat présidentiel pour assumer cette responsabilité à son tour.
Programmer sa démission serait une façon pour lui de sortir par le haut et, surtout, de préserver autant nos institutions que les intérêts du pays.
Une démission programmée permettrait d’organiser une véritable campagne présidentielle, de laisser le temps nécessaire à la confrontation des projets. Des élections législatives suivraient cette élection présidentielle, donnant au nouveau Président une vraie majorité. Retourner au peuple est la seule issue démocratique et républicaine.
Aujourd’hui, le président de la République a le choix entre deux voies.
Blocages. La première : s’accrocher au pouvoir jusqu’en 2027, laisser les crises s’accumuler, les blocages se répéter, et espérer que le temps finisse par arranger les choses.
La seconde : prendre acte de l’impasse et en tirer les conclusions en préservant nos institutions et en rendant le pouvoir aux urnes, donc au peuple pour doter à nouveau le pays d’un gouvernement capable d’agir.
La première voie peut conduire à l’effondrement et à la crise de régime. La seconde permettrait un renouveau démocratique par un acte gaullien.
Ce qui se joue aujourd’hui dépasse la personne d’Emmanuel Macron. C’est la capacité de nos institutions à se régénérer qui est en question. C’est la confiance des citoyens dans la démocratie représentative qui est en jeu. C’est la possibilité même de gouverner la France qui est à reconquérir.
Les institutions de la Ve République ont été conçues pour permettre au pays d’être gouverné. Elles le permettent encore, à condition que ceux qui les incarnent sachent s’effacer quand ils ne peuvent plus les faire vivre. C’est cette sagesse républicaine qui devrait s’imposer. Ainsi va la France.
Retrouvez cette chronique sur le site de l’Opinion en cliquant ici.
« La seule solution, c’est la démission d’Emmanuel Macron »
Invité ce matin de la matinale En toute franchise sur TF1, face à Adrien Gindre, David Lisnard a dénoncé le chaos institutionnel et budgétaire engendré par la dissolution de 2024. Le président de Nouvelle Énergie appelle à un sursaut et au redressement des comptes publics : « La seule issue conforme à l’esprit de la Ve République, c’est la démission. »

Invité de la matinale En toute franchise sur TF1, David Lisnard a vivement critiqué « l’incohérence ajoutée à la confusion » dans laquelle s’enfonce la France depuis la dissolution de 2024.
Rappelant que la réforme des retraites, pourtant « réformette », permettait « 6,5 milliards d’économies immédiates », il dénonce « l’abandon de la seule réforme qui ralentissait un peu la hausse des dépenses publiques ».
« On nous démontre à juste titre qu’il faut rétablir les comptes publics, et on penserait qu’abandonner la seule réforme allant dans ce sens serait positif ? »
Pour le président de Nouvelle Énergie, la « stabilité » est devenue un mot creux, « le nouveau mantra de ceux qui veulent rester au pouvoir », alors même que leurs politiques « créent l’instabilité économique et sociale ».
« On voit bien l’hypocrisie de tout cela. C’est un grand théâtre. Il faut en sortir. »
David Lisnard refuse toute participation des Républicains au gouvernement, estimant qu’il serait absurde de « devenir la béquille de ce que nous combattons depuis dix ans ».
« La seule solution, c’est la démission. C’est ça, l’esprit de la Ve République. Le général de Gaulle l’a montré en 1969 : quand le peuple dit non, on part. »
Il plaide pour une démission programmée avant l’été prochain, le temps d’un gouvernement technique pour assurer la continuité budgétaire avant une élection présidentielle ouverte.
« Ce serait un retour à la stabilité et à la clarté institutionnelle. »
Interrogé sur sa propre préparation, le président de Nouvelle Énergie assume :
« Nous sommes prêts. Nous portons un projet libéral, sécuritaire et éducatif. Libérer la société civile, restaurer l’autorité régalienne et refonder l’école : c’est la clé du redressement national. »
Et de conclure :
« Être au pouvoir n’est qu’une modalité. La finalité, c’est de redresser le pays. »
Voir le replay en cliquant ici.
Entre Israël et le Hamas, Emmanuel Macron choisit MUNICH
Le 7 octobre 2023, 1 189 personnes étaient massacrées en Israël : des enfants décapités, des femmes violées puis exécutées, des familles entières brûlées vives. Les néonazis islamistes du Hamas filmaient leurs crimes et les exhibaient avec fierté. Une tribune de David Lisnard parue le 7 octobre 2025 sur le média Rupture-mag.

L’horreur ne se cachait pas, elle s’affichait dans un délire psychotique où le sadisme le disputait à la pulsion génocidaire. Ce pogrom, le plus meurtrier contre des Juifs depuis la Shoah, a marqué le retour au premier plan de l’antisémitisme exterminateur, assumé et revendiqué.
Cette barbarie n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans un projet islamiste global, soutenu par l’Iran et relayé par le Hezbollah. Un axe de la terreur qui instrumentalise la cause palestinienne pour son projet totalitaire.
Car il ne faut s’y tromper : si un document de 2017 recentre le combat du Hamas sur la lutte contre « le projet sioniste », sa charte de 1988, qui appelle explicitement à détruire Israël et à tuer les juifs, n’a jamais été révoquée. Cette idéologie criminelle vise donc à la fois un État et un peuple.
En France, pas de compassion unanime pour les victimes. Pas de « Je suis juif » comme il y eut « Je suis Charlie ». Pas de Président de la République au cœur de la mobilisation du 12 novembre 2023 contre l’antisémitisme qui a explosé dès avant la riposte israélienne à Gaza.
Depuis deux ans, les chiffres donnent le vertige : 1 676 actes antisémites en 2023, encore 1 570 en 2024, contre 436 en 2022. Dans les universités, théâtres de cette dérive, les actes ont doublé en un an, dans les écoles, on recensait quatre fois plus d’actes antisémites en 2023/2024.
Par cynisme électoral, par lâcheté, par haine d’Israël, tous ceux qui favorisent cet antisémitisme sous couvert d’antisionisme ou de solidarité avec les Palestiniens portent une responsabilité écrasante dans cette contagion qui gagne une partie de la jeunesse et sape la cohésion nationale.
En comparant le Hamas à un « mouvement de résistance », en qualifiant ses crimes de « résistance légitime », l’extrême-gauche a libéré la parole antisémite, donné des justifications aux bourreaux et participé de l’inversion victimaire qui présente l’agresseur comme la victime et la démocratie israélienne comme l’oppresseur.
C’est aussi ce qui rend incompréhensible la décision d’Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien alors que les conditions qu’il avait lui-même fixées ne sont toujours pas remplies. Cette décision fait abstraction des otages encore détenus, de la menace existentielle qui pèse sur Israël et de l’emprise intacte du Hamas sur Gaza.
Tout cela ne revient pas à légitimer l’ensemble des actions entreprises par le gouvernement israélien, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie.
Et la paix à deux États reste l’horizon nécessaire.
Mais cette reconnaissance prématurée désarme la France diplomatiquement et fragilise encore un peu plus la lutte contre l’antisémitisme quand tant de nos compatriotes juifs disent ne plus se sentir en sécurité dans nos rues.
L’histoire nous l’enseigne : ce qui commence par les Juifs ne s’arrête jamais aux Juifs. C’est la République qui est visée, notre cohésion nationale qui est attaquée, notre liberté qui est menacée.
La France fait face à un nouveau Munich. Reconnaître un État palestinien aux mains des complices du Hamas, c’est capituler. Tolérer que des élus refusent de qualifier le Hamas de terroriste, c’est capituler. Laisser l’antisémitisme gangréner nos écoles, c’est capituler.
Ceux qui capitulent aujourd’hui devant l’islamisme seront les esclaves de demain. Ceux qui résistent aujourd’hui seront des hommes libres.
Retrouvez cette tribune sur le site de Rupture-mag en cliquant ici.
« L’autorité républicaine n’est pas l’ennemie de la liberté : elle en est la condition »
Face au déclin français, David Lisnard propose une rupture claire : substituer à l’État-providence un État-performance, recentré sur ses missions régaliennes, la responsabilité individuelle et la liberté économique. Retrouvez le Grand entretien du Diplomate avec David Lisnard.
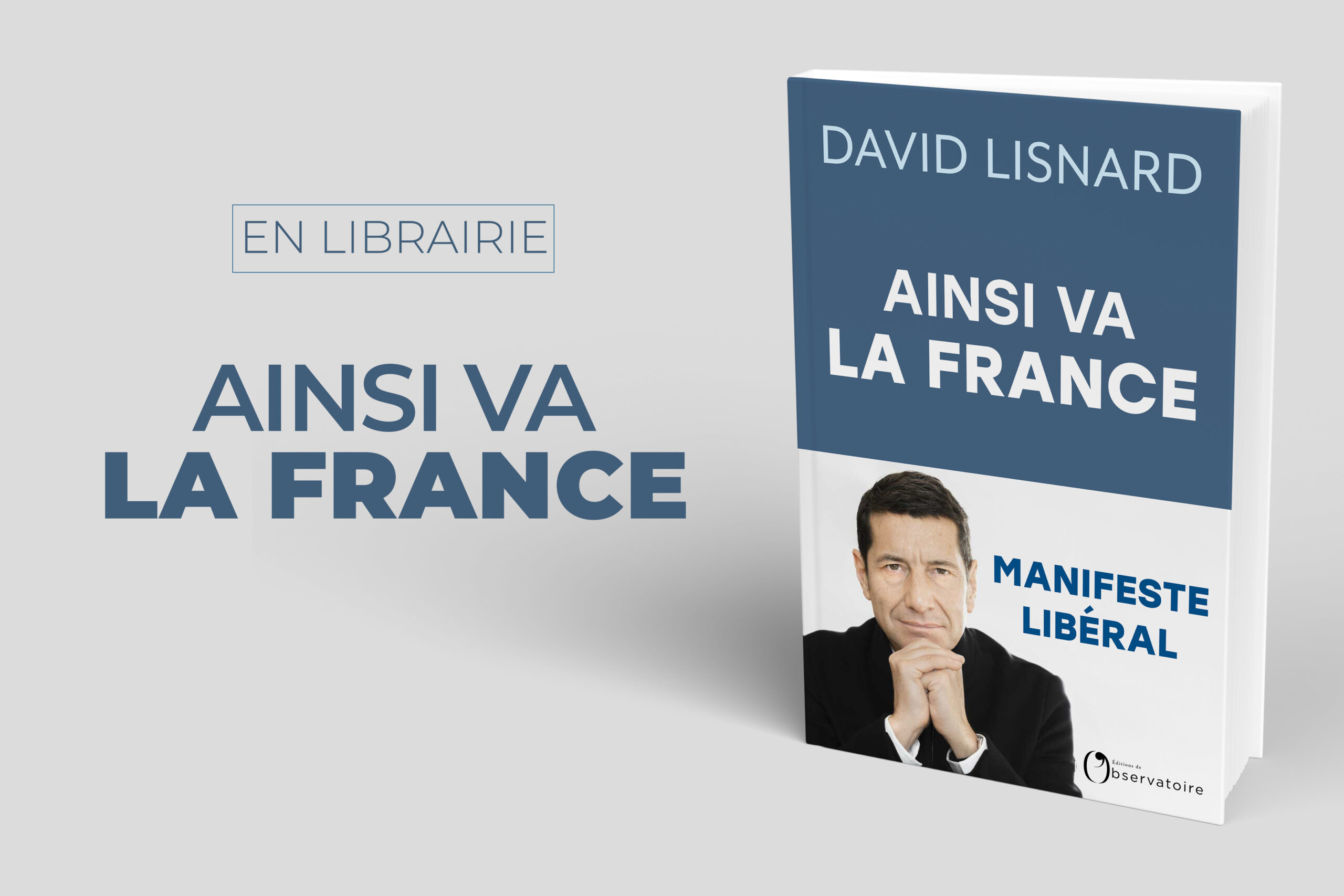
Publié en mars 2025 aux Éditions de l’Observatoire, Ainsi va la France, Manifeste libéral, propose un diagnostic sans fard du déclassement français et un agenda de réformes axé sur la liberté économique, la responsabilité et la décentralisation. Cette discussion intervient alors que David Lisnard, maire de Cannes, préside à la fois l’Association des maires de France (AMF) et le mouvement Nouvelle Énergie, et défend inlassablement l’idée d’un « État performance ».
Propos recueillis par Roland Lombardi
Le Diplomate : Pourquoi un « manifeste libéral » maintenant ? Quelle est la thèse centrale qui traverse l’ouvrage (problème, démonstration, propositions), et en quoi se distingue-t-elle des essais politiques déjà publiés ces dernières années sur le déclin français ?
David Lisnard : Parce que le moment l’exige. Ce livre est né d’une nécessité : celle de dire clairement que la France est entrée dans un cycle de déclassement rapide, visible, et trop accepté avec fatalisme. Ce que nous vivons n’est pas une simple crise passagère, mais une dégénérescence profonde du modèle social-étatiste, et d’un État-providence à la fois inefficace, infantilisant et ruineux.
Ce manifeste est une réponse politique à cette urgence.
C’est d’abord un constat. Celui du gâchis français ces dernières décennies, proportionnel à notre potentiel de prospérité, et désormais celui d’une France qui s’effondre dans de nombreux domaines vitaux – école, sécurité, justice, santé, industrie, natalité, culture, énergie.
Elle est championne du monde de la dépense publique, des prélèvements obligatoires, des normes absurdes et de la dette. Elle étouffe sous une bureaucratie qui empêche d’agir, une culture de l’irresponsabilité qui dévalorise l’effort et une déconnexion croissante entre une certaine caste au pouvoir et l’immense majorité des Français.
Ensuite, la démonstration s’appuie sur des situations concrètes vécues sur le terrain, comme maire, comme petit commerçant et entrepreneur, comme président de l’Association des maires de France. Ces différentes expériences me permettent de confronter chaque jour la réalité à l’abstraction administrative.
Enfin, les solutions : substituer l’Etat-performance à l’État-providence, c’est-à-dire reconstruire un État fort et efficace sur ses missions régaliennes, rendre leur autonomie aux collectivités, libérer la création de valeur, refonder l’école et notre système de santé, mener une politique nataliste ambitieuse, combattre le wokisme et l’islamisme, et retrouver une culture de la responsabilité.
Je n’ai pas voulu écrire un énième livre sur le déclassement français. Beaucoup l’ont fait et bien fait. Ce manifeste, est d’abord un outil pour tous ceux qui refusent de céder au fatalisme et veulent reconstruire un pays libre, juste et puissant. Il apporte des solutions concrètes puisées aux sources de la pensée libérale et du fameux carré magique « Liberté ; Responsabilité ; Propriété ; Dignité ».
Votre manifeste part d’un constat de “déclassement”. Si vous ne deviez retenir que trois leviers immédiats (12–18 mois) pour enrayer ce déclassement sans aggraver le déficit, lesquels seraient-ils et quels ordres de grandeur budgétaires et réglementaires y associez-vous ?
C’est la baisse des dépenses et du déficit qui va nous fournir des leviers de croissance et de progrès. Cela, couplé à une remise en ordre profonde organisationnelle de l’Etat et sécuritaire. Tout est lié.
Notre projet repose sur une conviction simple : la France peut redevenir performante en diminuant les prélèvements et le déficit, à condition d’assumer des réformes structurelles courageuses, immédiates et lisibles.
Nous avons un cap clair : ramener la dépense publique au moins dans la moyenne européenne. Cela suppose un plan d’économies de 200 à 300 milliards d’euros, dont 60 à 80 milliards dès la première année, en supprimant les gaspillages, en réorganisant les pouvoirs publics, en mettant en concurrence les administrations et en les dirigeant, en ciblant les dépenses improductives, en réservant les prestations sociales non contributives aux Français.
Mais réduire la dépense ne signifie pas différer l’action. Car le déclassement que je décris n’est pas seulement économique : il est d’abord intellectuel, moral et civique. C’est pourquoi je place l’éducation au premier rang des priorités au regard des résultats catastrophiques obtenus dans tous les classements internationaux.
L’école a pour mission de transmettre les savoirs, de former l’intelligence, de cultiver la raison critique. Elle n’a pas à engager les élèves dans des combats idéologiques, ni à se substituer à la famille, ni à refléter les injonctions du moment. Elle doit permettre à chaque enfant, quel que soit son milieu, d’accéder aux humanités, aux sciences, à la langue, à la culture et à la rigueur intellectuelle.
Depuis des décennies, l’institution scolaire a été affaiblie par un pédagogisme dominant, qui a disqualifié les savoirs au profit de méthodes floues, relativistes, déstructurantes. Ce choix idéologique et égalitariste a produit une école moins exigeante et plus inégalitaire. Le système a échoué parce qu’il s’est éloigné de ce qui fonde l’émancipation : la méritocratie par l’instruction.
Nous engagerons une transformation profonde fondée sur quatre principes : transmission, exigence, liberté, responsabilité.
Au-delà du nécessaire recentrage sur les savoirs fondamentaux – avec un certificat de fin de primaire pour valider les acquis et conditionner le passage en 6ème, nous supprimerons la sectorisation scolaire en milieu urbain, nous permettrons l’autonomie des établissements, nous établirons une élection rigoureuse à l’entrée dans le métier d’enseignant, nous mettrons fin à l’endoctrinement à l’école, par le retrait des programmes de tout contenu militant.
Ces mesures relèvent de la décision politique, du décret et de la circulaire. Nous voulons une école de la raison, du mérite, de la liberté éducative, et non un système bureaucratique soumis à la pensée dominante.
Le deuxième levier est la simplification radicale de l’action publique, fondée sur la clarté des responsabilités, la réduction des normes, et le réarmement des fonctions stratégiques de l’État.
L’organisation de l’action publique repose sur un modèle épuisé, centralisé, segmenté, opaque, coûteux. L’empilement des structures, la prolifération des normes, le morcellement des compétences, l’irresponsabilité administrative ont rendu l’État incapable d’agir efficacement. Le millefeuille administratif – directions, agences, opérateurs, autorités, inspections – paralyse la décision, alourdit les procédures et dilue les responsabilités.
Nous engagerons une réforme d’ensemble de l’organisation administrative fondée sur trois priorités.
D’abord, supprimer nombre d’agences, d’opérateurs et de structures redondantes, en commençant par les secteurs les plus bureaucratisés : logement, écologie, emploi, santé. Cette rationalisation reposera sur une évaluation systématique de leur utilité, de leur coût, et de leur impact.
Les missions utiles seront réintégrées dans les administrations centrales ou déconcentrées, les doublons supprimés. Ensuite, simplifier les procédures et alléger la norme, en mettant fin à la culture du contrôle préalable systématique.
Nous remplacerons les autorisations par des déclarations, les circulaires par des cadres clairs, les seuils d’instruction par des délais garantis.
Nous responsabiliserons les niveaux d’exécution, en renforçant le rôle des préfets comme pilotes opérationnels, et en transférant les compétences de proximité aux collectivités territoriales dans le respect du principe de subsidiarité.
Ce plan de simplification est une condition de survie pour l’efficacité de l’action publique et pour le redressement des comptes. L’enjeu est aussi démocratique : en sortant de l’irresponsabilité administrative et de l’obésité normative, nous voulons restaurer la lisibilité de l’action publique, c’est-à-dire sa légitimité.
Enfin, le troisième levier que nous activerons est le contrôle migratoire, dont la politique est aujourd’hui à la fois inefficace, subie et dévoyée.
La France ne maîtrise plus ni les flux migratoires, ni les conditions d’entrée, ni les critères d’accueil. Non pas par manque de lois, mais parce que notre système est verrouillé par une architecture juridique complexe, dominée par les jurisprudences, les conventions internationales et les injonctions européennes. Cette situation crée une impuissance organisée où le juge se substitue à la volonté nationale. Il est devenu impossible de fixer des critères clairs d’entrée sur le territoire, d’expulser effectivement les étrangers délinquants, ou de conditionner les aides sociales à une durée suffisante de résidence et d’activité.
C’est pourquoi nous soumettrons aux Français un référendum pour permettre un changement de cadre juridique. Nous voulons inscrire dans la Constitution les principes qui nous redonneront la capacité de décider de notre politique migratoire.
Cette réforme permettra de redéfinir la hiérarchie des normes, d’écarter l’automaticité de l’acquisition de la nationalité donc de remettre en cause le droit du sol, de supprimer le regroupement familial, de restreindre les conditions du droit d’asile à ses fondements essentiels.
Par ailleurs, nous refusons le relativisme qui nie l’identité française au nom d’un multiculturalisme de circonstance.
L’assimilation n’est pas une idée d’hier, c’est une exigence républicaine d’aujourd’hui pour éviter les fractures de demain. Elle suppose une langue commune, une adhésion sans ambiguïté à nos principes, à notre art de vivre, et un refus explicite des comportements communautaristes, qu’ils soient fondés sur la religion, l’origine ou les appartenances ethniques.
Ces trois leviers sont les décisifs pour redresser notre pays, car ils touchent à l’essentiel : la formation des esprits, la capacité d’agir de l’État, et la cohésion de la nation. En les activant, nous engagerons un mouvement de transformation profond, au service de la liberté et de l’efficacité.
Vous opposez “État-providence” et “État-performance”. Concrètement, à quoi ressemble cet État dans l’école, la santé et la sécurité au quotidien (indicateurs de résultats, gouvernance locale, responsabilité des gestionnaires) ? Quels mécanismes d’évaluation publique obligatoires généraliseriez-vous en priorité ?
L’État-providence est à bout de souffle. Son modèle reposait sur une croissance forte, une démographie dynamique, une immigration limitée et orientée vers le travail. Ces trois piliers ont disparu. Ce qui subsiste, c’est un système hypertrophié, inefficace et clientéliste, qui produit de la dette plus que des résultats. L’Etat-providence aujourd’hui appauvrit ceux qui travaillent et investissent, et subventionnent l’oisiveté. L’État-Performance que nous défendons se recentre sur ses missions régaliennes, assure les services publics essentiels, garantit la sécurité juridique, abandonne la prétention à tout encadrer, tout subventionner, tout piloter.
La règle sera que chacun doit faire sa vie et délègue ce qui relève de la justice et de la sécurité collective à l’État.
Un État-performance, c’est un État qui a des objectifs qualitatifs et quantitatifs, évalue ce qu’il fait, assume ses choix, publie ses résultats, se modernise et utilise tous les outils actuels de la robotique et de l’IA, supprime ce qui ne fonctionne pas, et où la légitimité de l’action publique repose sur la clarté des objectifs, la responsabilité individuelle des décideurs et des exécutants, l’obligation de rendre des comptes, et non sur la fuite en avant dépensière.
Concrètement, pour reprendre vos exemples, cela signifie dans l’école, une transformation complète du pilotage public. L’indicateur premier ne peut plus être le taux de dépense par élève, mais la progression réelle des acquis. Nous proposerons que chaque établissement publie annuellement un bilan pédagogique synthétique comprenant les résultats aux évaluations nationales (notamment en CM1 et 4e) et les progrès constatés par niveau. Le directeur d’établissement doit devenir un chef d’équipe à part entière, libre et responsable des recrutements (avec une autonomie élargie), de l’organisation, du climat scolaire et de l’articulation avec les collectivités.
Dans la santé, l’État-Performance repose sur deux principes : l’accès effectif aux soins pour chacun, et la responsabilisation des gestionnaires hospitaliers. Nous proposons de publier chaque année un rapport de performance hospitalière par établissement, fondé sur le délai moyen d’accès aux urgences, le taux de lits fermés, la part des dépenses non médicales dans le budget, le taux de satisfaction des patients et le taux de rotation des personnels. En parallèle, la tutelle des ARS, structures opaques et hors-sol, sera supprimée.
La formation médicale, qui doit rester très exigeante sur sa qualité, sera libérée pour permettre un plus grand nombre d’établissements universitaires, aux financements libres, sur tout le territoire.
En matière de sécurité, l’évaluation doit porter sur les résultats opérationnels. Nous proposons un indicateur synthétique de performance locale rendant publics, pour chaque circonscription, les taux d’élucidation, les temps moyens d’intervention, la présence effective des effectifs sur la voie publique, et le taux d’exécution des peines. Les polices municipales, dans les communes qui le souhaitent, verront leurs compétences renforcées dans un cadre expérimental sous contrôle judiciaire.
Ces évolutions sectorielles s’inscrivent dans une transformation plus profonde : le passage d’une administration de moyens à une culture du résultat. Cela suppose une rupture nette avec le réflexe bureaucratique. Le contrôle sera a posteriori, objectif, rigoureux. Il ne bloquera plus l’usage du plus grand nombre mais ciblera les abus des déviants. Ce changement de paradigme impliquera une révision du droit administratif, en particulier sur les mécanismes d’autorisation. Il faut passer d’un régime d’autorisations préalables à un régime de responsabilité individuelle.
Nous généraliserons l’évaluation annuelle obligatoire des politiques publiques. Chaque programme, chaque opérateur, chaque administration fera l’objet d’une note publique de performance, accessible et comparable, croisant trois dimensions : efficacité, coût et résultats tangibles.
La numérisation stratégique des services publics suivra un modèle clair : automatisation des fonctions support, interopérabilité des systèmes, recours à l’intelligence artificielle pour anticiper les besoins, ce qui permettra au passage de remettre de l’humain au contact du public. Le numérique doit libérer du temps et permettre d’avoir plus d’agents sur le terrain, non pas créer davantage de contraintes.
Enfin, la transparence sera la règle. Chaque hôpital, école, tribunal, collectivité devra publier ses résultats, ses dépenses, ses indicateurs-clés. Le citoyen a le droit de savoir, pour pouvoir juger.
Décentralisation et pouvoir local. À l’AMF, vous plaidez pour “laisser agir les communes”. Quelles compétences et quels flux financiers transféreriez-vous tout de suite au bloc communal/régional, et comment éviter l’effet “millefeuille” (doublons, normes) que vous dénoncez ?
La France étouffe sous le poids d’un État central qui prétend tout savoir, tout prévoir, tout contrôler, mais qui ne sait plus rien faire correctement. Nous voulons rompre avec ce centralisme inefficace, pour construire une République des responsabilités fondée sur une vraie subsidiarité ascendante.
Cela suppose une réforme structurelle articulée autour de trois piliers : clarification des compétences, autonomie fiscale, et responsabilité locale.
Nous proposons de créer des Provinces en lieu et place des départements et régions, dotées de compétences stratégiques (formation, infrastructures, développement économique) et d’une fiscalité propre.
Le bloc communal serait consolidé sur toutes les politiques de proximité : urbanisme, logement, sécurité du quotidien, environnement, petite enfance, mobilités, services sociaux de premier niveau.
Cette réforme mettra fin aux doublons multiples et aux responsabilités diluées.
Le levier fiscal est déterminant. Nous restaurerons une véritable autonomie fiscale locale, fondée sur trois principes clairs :
- Réintroduction d’un impôt économique local dynamique, notamment via l’attribution directe d’une part de l’impôt sur les sociétés aux communes et aux provinces, pour recréer un lien entre développement économique local et financement public ;
- Les collectivités doivent pouvoir moduler certains impôts ou contributions, au lieu de subir des dotations figées ou des impôts décidés à Paris sans contrepartie locale ;
- Fin du système de dotations opaques et centralisées : la dotation globale de fonctionnement (DGF) doit être remplacée par des ressources propres prévisibles, pour que les collectivités cessent d’être des guichets dépendants du bon vouloir de Bercy.
Nous voulons également donner aux communes un véritable pouvoir réglementaire local, pour adapter les normes nationales aux réalités du terrain. Les maires ne peuvent plus être entravés par des règles irréalistes décidées à Paris, comme la loi SRU ou le ZAN institué par la loi Climat.
Pour lutter contre le millefeuille administratif, nous appliquerons une règle d’airain : une compétence, un décideur, un financeur. Les agences administratives redondantes seront supprimées. L’organisation territoriale de l’État sera recentrée autour du préfet, unique interlocuteur des élus. Les collectivités publieront chaque année leurs résultats, dépenses, et indicateurs clés.
Enfin, nous mettrons fin à la contractualisation léonine imposée par l’État central. La libre administration n’est pas un privilège, c’est un principe constitutionnel. Il doit être restauré pleinement.
Compétitivité et réindustrialisation. Votre livre évoque une reconquête industrielle (automobile, spatial, IA). Quelles mesures ciblées—fiscales, sociales, énergétiques—permettraient de relocaliser des chaînes de valeur sans subventionner des “canards boiteux” ? Quels critères d’« exit » imposer aux aides publiques ?
La réindustrialisation ne se fera pas à coups de chèques. La priorité n’est pas d’inventer de nouveaux dispositifs, mais de libérer les forces productives aujourd’hui paralysées par un cadre hostile à l’investissement, à la disponibilité du foncier à l’embauche et à la prise de risque.
Le premier levier est fiscal. La France reste l’un des pays qui taxe le plus la production, avec 3,7 % du PIB contre 0,8 % en Allemagne. Il faut supprimer immédiatement la C3S, impôt anachronique sur le chiffre d’affaires, et poursuivre la baisse des impôts de production dans une trajectoire claire et irréversible.
La fiscalité sur les transmissions d’entreprise doit être allégée pour éviter les ruptures de capital productif, en particulier dans les PME industrielles et les ETI. Les différentes aides publiques aux entreprises ne peuvent pas compenser une fiscalité globale étouffante. Plutôt que de subventionner en aval, mieux vaut desserrer l’étau en amont. Donc, le principe sera de supprimer les aides aux entreprises et l’excès de prélèvements qui pèsent sur elles.
Cela enlèvera de la bureaucratie et donc des pertes financières, de la complexité, de l’opacité, et donc nous permettra de lutter contre le capitalisme de connivence qui accompagne l’interventionnisme étatique.
Le deuxième levier est social. Il faut réécrire le droit du travail pour simplifier les procédures, sécuriser les embauches et donner plus de marge aux accords d’entreprise. Une plus grande liberté contractuelle et la déjudiciarisation de certains contentieux du travail sont des conditions indispensables pour redéployer une base industrielle solide.
Le troisième levier est énergétique. Le nucléaire doit redevenir notre pilier stratégique : prolongation du parc existant, construction de nouveaux EPR, développement des petits réacteurs modulaires, soutien à la recherche sur la fusion. Le prix de l’électricité pour les industriels doit être sécurisé par un mécanisme de contrat long terme fondé sur le coût réel du nucléaire, en rupture avec les absurdités du marché européen.
Le quatrième levier est réglementaire. L’implantation d’usines ou de centres de production ne peut plus prendre des années comme aujourd’hui. Il faut créer un guichet local d’autorisation industrielle avec un délai maximal de six mois. La règle doit être : un porteur de projet, un interlocuteur, un calendrier. Les normes environnementales doivent être évaluées dans leur faisabilité, avec des objectifs maintenus mais des procédures simplifiées. Il faut rompre avec la naïveté réglementaire qui pénalise nos industries et favoriser des coalitions volontaires sur les secteurs critiques : IA, quantique, spatial, défense, batteries, semi-conducteurs.
Le cinquième levier est financier. Il faut orienter notre épargne vers l’économie productive. Aujourd’hui, elle reste trop peu investie dans l’industrie. Cela passe par l’introduction d’un pilier de retraite obligatoire par capitalisation, qui permettra aux Français de constituer leur propre patrimoine retraite. Ce système, fondé sur la responsabilité individuelle, permettra de mobiliser cette épargne vers les PME et ETI industrielles. L’objectif est de réduire la dépendance au financement étranger et de reconstituer un actionnariat stable, sans créer de nouveaux mécanismes publics de redistribution ou de véhicules étatiques bureaucratiques.
Enfin, cette stratégie industrielle ne réussira que si elle est adossée à une ambition éducative et technologique. Nous proposons de renforcer les partenariats entre entreprises et établissements d’enseignement, de créer des chaires d’entreprises dans les secteurs critiques (IA, transition énergétique, cybersécurité, etc.) et de réformer le compte personnel de formation, aujourd’hui trop complexe et peu lisible.
Si l’État intervient, ce doit être de façon exceptionnelle, temporaire et conditionnée. Toute aide publique doit être assortie de critères d’« exit » clairs : durée limitée, objectifs contractuels mesurables, remboursement en cas d’échec. L’enjeu doit être de faciliter des transitions ou des investissements stratégiques à fort effet de levier.
La France n’a pas besoin d’un énième plan industriel. Elle a besoin d’un environnement cohérent, stable et libéré des carcans fiscaux, sociaux et bureaucratiques. L’industrie ne demande pas des subventions : elle réclame de la liberté, de la lisibilité et de la compétitivité.
Moment politique. Dans une France contrainte par la trajectoire des comptes publics et la dispersion des forces parlementaires, quelle coalition d’idées jugez-vous réaliste pour faire adopter un paquet de réformes libérales (marché du travail, dépense, fiscalité locale) d’ici 2026 ? Et quelles concessions êtes-vous prêt à consentir pour bâtir une majorité d’action ?
Le pays a déjà beaucoup trop souffert des concessions et autres compromis.
Dans un pays marqué à la fois par une trajectoire budgétaire intenable et par un émiettement parlementaire chronique, la seule coalition d’idées réaliste est celle qui assume une ligne de rupture libérale, structurée autour de trois priorités : libérer le travail, assainir les finances publiques et restaurer l’autorité de l’État dans ses fonctions régaliennes.
Il ne s’agit pas de reconstituer artificiellement une majorité parlementaire introuvable, mais de créer une dynamique politique fondée sur la clarté des idées et la force du projet. Cette dynamique ne peut émerger que d’un mandat présidentiel clair, obtenu au suffrage universel sur la base d’un programme cohérent. C’est la condition indispensable pour surmonter la crise politique et institutionnelle actuelle.
Une telle majorité suppose de fédérer tous ceux qui refusent la fuite en avant budgétaire, qui ne se résignent pas à l’impuissance publique, et qui sont prêts à porter un programme d’efficacité régalienne, de liberté économique et de responsabilité locale. Les convergences existent : elles doivent être identifiées, assumées, puis traduites en propositions législatives concrètes.
Je suis prêt à discuter des modalités si elles permettent de construire cette majorité d’action. En revanche, je ne transigerai pas sur le fond. Aucune concession ne sera possible sur les principes : pas de relèvement de la fiscalité, pas de nouvelles dépenses sans économies équivalentes, pas de compromission avec les corporatismes ou les logiques de rente.
Culture civique et ordre républicain. Vous insistez sur la restauration de l’autorité et de la confiance (école, justice, police). Quelles réformes juridiques et administratives immédiates proposerez-vous pour rétablir l’effectivité des sanctions et la protection des agents publics, sans sacrifier les libertés ?
Nous vivons une crise profonde de l’autorité publique. Elle mine la confiance civique, désarme les institutions, et rend impossible toute cohésion nationale. Cette crise ne résulte pas d’un vide normatif, mais d’un excès de règles et d’un effondrement de l’exécution.
Rétablir l’autorité ne signifie pas multiplier les lois, mais au contraire d’en supprimer et de faire respecter celles qui sont nécessaires. Cela suppose de rendre les sanctions certaines, rapides et visibles.
Sur le plan général, la première réforme doit donc porter sur l’exécution des peines. Toute peine prononcée doit être réellement effectuée, une fois purgées bien sûr les procédures contradictoires et les recours qui font l’état de droit.
Cela exige la suppression des réductions automatiques de peine (crédits de réduction de peine forfaitaires), l’exécution provisoire obligatoire pour toutes les infractions graves qui peuvent être réitérées et mettent en péril l’intégrité des personnes et l’interdiction de tout aménagement de peine pour les infractions commises en état de récidive, ou portant atteinte à l’intégrité physique.
Pour cela, il faut augmenter la capacité carcérale d’au moins 30 000 places, dont une part dédiée et adaptée aux peines courtes comme aux primo délinquants.
L’effectivité des peines exige aussi une justice accélérée et priorisée. Une présomption de comparution immédiate doit s’appliquer à toutes les infractions commises en flagrance, en particulier lorsqu’elles visent des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions — enseignants, policiers, personnels soignants, de secours et de transport.
Dans les cas les plus graves, une peine ferme doit pouvoir être prononcée et mise à exécution sous 72 heures, sans délai ni aménagement.
Pour garantir cette rapidité et cette cohérence, il convient de créer des pôles spécialisés au sein de chaque tribunal judiciaire, spécifiquement affectés au traitement des infractions contre les agents publics dont la protection doit être un axe structurant de la politique pénale.
L’autorité implique également de rétablir le lien entre droits sociaux et devoirs fondamentaux. Je propose en conséquence la suspension de l’accès aux prestations sociales non contributives en cas de condamnation pénale pour violences volontaires ou délits répétés, l’expulsion administrative sur décision motivée du maire des logements sociaux en cas de trouble grave à l’ordre public ou condamnation pénale d’un occupant, l’expulsion systématique des étrangers condamnés pour délits ou crimes. Le droit de séjour implique le respect de la loi.
L’autorité repose aussi sur l’éducation civique et la prévention. L’école doit redevenir un lieu d’apprentissage de la loi, de l’histoire nationale, de la laïcité, des principes républicains.
Enfin, il faut rompre avec trois logiques délétères : l’impunité de fait, la judiciarisation sans exécution, et la compassion systématique envers les coupables. La France doit être respectée et pour cela la République ne peut plus reculer. Elle doit assumer la force juste, celle qui protège les gens honnêtes, et faire respecter la loi, sans faiblesse ni complaisance.
L’autorité républicaine n’est pas l’ennemie de la liberté : elle en est la condition.
Retrouvez le Grand entretien avec David Lisnard sur le site du Diplomate en cliquant ici.
David Lisnard chez Kaotik : « Réalisme, responsabilité, résultats »
Dans un entretien franc et dense accordé à Kaotik, David Lisnard a détaillé sa vision : rétablir nos comptes, rompre avec la surfiscalité, remettre l’autorité et la responsabilité au cœur de l’action publique — et bâtir un État-performance au service des Français.

Ce qu’il faut retenir
•Fin d’un cycle : « L’État-providence est mort. » Place à un État moderne, efficace, recentré sur ses missions régaliennes (justice, sécurité, protection) et appuyé sur l’IA et le numérique.
•Redressement des comptes : alerte sur une dette hors de contrôle ; priorité à la baisse durable de la dépense plutôt qu’aux hausses d’impôts.
•Compétitivité & travail : refus des taxes “magiques” (type taxe sur la valorisation des patrimoines) qui chassent l’investissement et les talents ; objectif de redonner du pouvoir d’achat par le travail.
•Ordre & justice : exécution réelle des peines, + de places de prison, établissements fermés dédiés aux mineurs délinquants, réponse pénale rapide et lisible.
•Responsabilité & dignité : propriété privée, responsabilité individuelle, mérite et effort comme piliers d’une société libre et efficace.
•Politique étrangère & fermeté : relations fondées sur la réciprocité (visas, OQTF, aide au développement) et le respect des intérêts français.


« On doit rompre avec un système qui ne tient plus : toujours plus d’impôts, de dettes et de normes. Nouvelle Énergie propose un État-performance, recentré sur ses missions, qui protège, libère la création de richesse et récompense l’effort. »
Et maintenant ?
Nouvelle Énergie porte un plan d’action libéral, sécuritaire et éducatif : baisse de la dépense publique, libération de l’économie réelle, autorité de l’État retrouvée, école d’exigence — pour relever la France et rendre à chacun la maîtrise de sa vie.
La chute de l’agriculture française
La situation de l’agriculture française ne cesse de se dégrader, prise comme elle se trouve entre les normes européennes et françaises qui handicapent sa compétitivité, et de mauvais accords commerciaux qui l’exposent à une concurrence injuste. Une tribune de David Lisnard et Yves d’Amécourt parue sur Atlantico.

Il y a des chiffres qui résonnent comme des coups de tonnerre. En 2024, l’excédent agricole français est tombé à 4,9 milliards d’euros, un plus bas inédit depuis plus de 20 ans. À la fin de l’été 2025, l’excédent cumulé — vins et spiritueux inclus — n’était plus que de 47 millions d’euros. Et pour la première fois depuis cinquante ans, un basculement historique est en passe de se produire : notre pays pourrait finir l’année avec un déficit agricole.
L’excédent commercial agricole, longtemps source de fierté nationale, jouait le rôle d’un bouclier stratégique : quand nos industries manufacturières reculaient et que le déficit commercial global se creusait, l’agriculture restait ce pilier qui tenait encore l’édifice. Le voir s’effondrer aujourd’hui, c’est comme voir se fissurer la dernière arche d’un pont déjà fragilisé.
Ce n’est pas seulement un problème économique. C’est aussi une question d’identité. La France n’est pas qu’un territoire : elle est une somme de terroirs, une culture, un art de vivre, une terre façonnée par des siècles de travail paysan. Quand nos campagnes déclinent, ce sont nos racines qu’on abîme, c’est toute la nation qui vacille.
Nos agriculteurs sont parmi les plus compétents du monde. Ce qui les étouffe, ce sont des chaînes invisibles mais puissantes : normes, coûts, dépendances, choix politiques incohérents.
Chaque semaine, un agriculteur consacre en moyenne neuf heures à remplir des formulaires, répondre à des contrôles, justifier ses pratiques. Neuf heures volées aux champs, aux vignes, aux troupeaux. C’est l’équivalent de cent mille emplois à temps plein absorbés par la bureaucratie.
La France applique non seulement les normes européennes, mais elle y ajoute des exigences supplémentaires. On en a recensé 137 dans le secteur agricole et environnemental. Résultat : un agriculteur français doit respecter plus de contraintes que son voisin allemand ou espagnol, tout en vendant sur le même marché. C’est un suicide économique. Il n’y a pas de libre échange possible sans normes de productions communes.
À cela s’ajoutent de mauvais accords commerciaux. Le commerce international est, depuis des siècles, un vecteur de prospérité et de progrès. Il a permis aux nations de se spécialiser selon leurs atouts naturels et leurs savoir-faire, d’échanger leurs productions complémentaires, de diffuser les innovations techniques d’un continent à l’autre. Par le commerce, les peuples ont accédé à des produits qu’ils ne pouvaient fabriquer eux-mêmes, les prix ont baissé, les revenus se sont élevés, les famines ont reculé.
L’agriculture française en a largement bénéficié : nos vins, nos céréales, nos productions d’excellence ont conquis les marchés mondiaux. Le libre-échange, qui doit reposer sur des règles équitables, demeure un essentiel facteur de développement.
Mais cette approche repose sur un principe fondamental : le refus des distorsions de concurrence. Or aujourd’hui, nous ouvrons nos frontières à des produits fabriqués avec des règles sanitaires, sociales et environnementales bien moins strictes que les nôtres.
Pendant que nos producteurs se battent avec un bras attaché dans le dos, des cargaisons de poulets brésiliens ou de blé traité avec des pesticides interdits ici arrivent sur nos quais.
Il n’y a pas de libre-échange possible sans normes de production communes. L’Europe et la France doivent cesser d’interdire à leurs producteurs ce qu’elles autorisent à l’importation. Soit un mode de production présente des risques avérés pour la santé ou l’environnement : dans ce cas, il faut l’interdire partout, y compris aux frontières, conformément aux règles de l’OMC. Soit il ne présente pas de danger scientifiquement établi, et alors il doit être autorisé partout. C’est une question de cohérence et d’équité.
Aux distorsions de concurrence s’ajoute une dépendance structurelle : nos fermes dépendent massivement de l’étranger pour leurs fertilisants, leur énergie, parfois même leurs semences. Le prix du gaz, du diesel ou des engrais se décide loin de nos frontières, et une variation sur les marchés internationaux peut suffire à faire basculer une exploitation de la rentabilité à la faillite.
Trop souvent, nos produits quittent la France à l’état brut avant d’être transformés ailleurs, puis reviennent sur notre marché… plus chers. Nous exportons des pommes de terre et nous importons des frites. Nous vendons des céréales et achetons des pâtes et de la farine. Nous vendons nos veaux qui sont élevés ailleurs. Nos grumes de bois, deviennent des meubles ou du parquet à l’autre bout du monde. Chaque tonne de matière première qui part sans être transformée, c’est de l’emploi perdu, de la richesse qui s’évapore, et un territoire qui s’appauvrit.
Laisser cette situation perdurer, c’est accepter des campagnes désertées, des fermes qui ferment, des agriculteurs découragés et une perte d’emplois dans l’agroalimentaire et la logistique. C’est aussi accepter que la France oublie que le mot culture vient du mot cultiver.
Nous n’avons plus le temps des demi-mesures. Il nous faut un programme clair, ambitieux, pragmatique. Un programme qui libère nos agriculteurs au lieu de les étouffer. Il faut simplifier l’administration, mettre fin à la surtransposition, relocaliser la transformation, construire une souveraineté énergétique agricole, protéger les revenus et rééquilibrer la fiscalité.
Cette crise n’est pas seulement agricole. Elle pose une question politique fondamentale : voulons-nous être une nation qui produit ou une nation qui dépend ?
Jean d’Ormesson écrivait : « La France est plus grande que la France. » Elle l’est par sa langue, son histoire, sa culture. Mais elle l’est aussi par sa capacité à transformer la terre en paysage, la récolte en tradition, le travail en richesse, l’agriculture en fierté nationale.
Si nous perdons cela, nous perdons plus qu’un excédent commercial. Nous perdons une part de nous-mêmes. Il est encore temps d’agir. De rendre aux agriculteurs la liberté de produire. De rendre à la France la fierté de nourrir sa population et d’exporter.
Retrouvez cette tribune sur le site le site d’Atlantico en cliquant ici.
« Nous devons passer de l’État-providence à l’État-performance »
Mercredi 1er octobre, David Lisnard était l’invité de David Revault d’Allonnes sur Radio J. Au micro de la matinale, il a livré une analyse sans concession de la situation politique nationale.

Il a rappelé que la France traverse une crise profonde, « aggravée par l’absurde dissolution de l’été 2024 », et qu’aucune sortie durable n’est possible « tant qu’on n’aura pas régénéré un cycle démocratique, avec un nouveau président et un nouveau parlement ».
Pour lui, le cœur du problème tient à l’essoufflement d’un modèle :
« Nous sommes à la fin de l’État-providence : il faut construire l’État-performance, un État moderne, qui protège vraiment, qui décentralise, qui responsabilise et qui relance la prospérité. »
Il a également dénoncé la tentation récurrente de nouveaux impôts :
« Le bricolage du Titanic ne l’empêche pas de couler. Flatter l’opinion avec des taxes supplémentaires ne résout rien. La seule justice sociale, c’est de recréer de la production, du travail et de l’investissement compétitif. »
Enfin, interrogé sur l’avenir politique de la droite et sur les municipales, David Lisnard a insisté sur la nécessité de bâtir une véritable alternative démocratique :
« Le pouvoir pour le pouvoir ne sert à rien. Ce qui compte, c’est porter un projet de réformes radicales, puissantes et positives pour la France. »
Taxe Zucman ou les habits neufs du vieux collectivisme
Face à la démagogie fiscale, partagée de l’extrême gauche au RN, rappelons que l’impôt n’a pas à être moral, il doit être utile et efficace, ce qu’il n’est plus depuis longtemps. Une tribune de David Lisnard parue dans Valeurs Actuelles le 24 septembre 2025.

La France détient le record mondial en matière de taux de prélèvements obligatoires. Si la fiscalité créait la prospérité, nous serions le pays le plus riche du monde. Or, la réalité est cruelle: services publics dégradés, hôpital en crise, école qui s’effondre, économie atone, appauvrissement relatif en termes de PIB par habitant. Le problème n’est évidemment pas le manque de recettes fiscales mais il vient d’un État inefficace et dépensier. Et pourtant, nous assistons depuis des semaines à un détournement d’opinion publique à travers un débat daté et dépassé: taxer les « ultrariches » par le mécanisme de la taxe dite Zucman est ainsi devenu le nouvel étendard de l’égalitarisme fiscal, ce poison collectiviste qui préfère punir la réussite plutôt que favoriser la prospérité.
Comme souvent, ce qui peut paraître séduisant est ici trompeur et dangereux. Les 20 milliards de recettes annoncés relèvent en effet de la fiction comptable. Les estimations sérieuses, intégrant les effets d’évitement et l’exil fiscal, convergent vers 3 à 5 milliards au mieux la première année. Encore moins par la suite.
En réalité, le solde sera négatif car en s’attaquant à la propriété privée, on décourage l’investissement privé et la création de richesses. L’expérience de l’impôt sur la fortune (ISF) devrait nous servir: chaque euro prélevé s’accompagnait de pertes supérieures en capital détruit et en entrepreneurs exilés. L’Allemagne, la Suède, le Dane-mark, l’Autriche, les Pays-Bas ont supprimé leur impôt sur la fortune. La Norvège en fait le constat après des mois d’hémorragie fiscale. Partout, le bilan est identique: fuite des capitaux, destruction d’emplois, recettes dérisoires.
Cette taxe frapperait des actifs illiquides: parts d’ETI (entreprises de taille intermédiaire), actions non cotées, start-up en croissance. Elle confond valorisation et revenus, capital immobilisé et trésorerie disponible. Une entreprise qui réinvestit ses bénéfices n’a pas de liquidités pour payer. La mécanique est implacable: pour s’acquitter de l’impôt, il faut vendre des parts, diluer le capital français et ouvrir la porte aux fonds étrangers. Les vraies victimes ne seraient pas les supposés « ultrariches » qui partiront, ce seraient les salariés qui resteront.
Pour augmenter le pouvoir d’achat, il faut augmenter les revenus. Pour augmenter les revenus, il faut augmenter la production. Et la production précède toujours la distribution. Or, il n’y a pas de production sans capital, et pas de capital sans protection du droit de propriété.
Une telle taxe sur la détention d’actifs non monétisables revient à légitimer une forme de dépossession légale. Ce glissement est à la fois économiquement dangereux et politiquement malsain. Il installe l’idée que l’État a un droit de regard permanent sur ce que vous possédez, même en l’absence de revenus.
Face à cette démagogie fiscale, partagée de l’extrême gauche au Rassemblement national, en passant par tout le spectre politique, il faut rappeler que l’impôt n’a pas à être moral mais qu’il doit être utile et efficace, ce qui n’est plus le cas depuis longtemps. On le sait: trop d’impôt tue l’impôt. À partir d’un certain seuil, il tue le contribuable. Aujourd’hui, l’urgence n’est pas de taxer davantage, la priorité est de dépenser beaucoup moins. La dépense publique atteint un tel niveau qu’elle étouffe l’investissement privé, donc la croissance, donc les recettes futures. Cette réalité économique est vérifiable partout dans le monde.
Taxer le succès aujourd’hui, c’est sacrifier l’avenir. Ne commettons pas cette faute historique. Refusons la confiscation qui appauvrit. Choisissons la prospérité par l’investissement, la propriété et la liberté d’entreprendre.

Pas de pourboire pour l’Etat
Avez-vous envie de laisser un pourboire à l’Etat plutôt qu’au pompiste ou au serveur ? Moi, non. C’est pourtant ce qui est en gestation à Bercy. Retrouvez la chronique de David Lisnard pour l’Opinion.

Incapable de se réformer pour faire des économies, l’Etat continue de faire littéralement les poches des Français. Toujours aussi créatif quand il s’agit de remplir les caisses qu’il vide aussitôt, il pioche toujours plus profond, là où c’est facile.
Cynisme. A partir de janvier 2026, il s’apprête à franchir un nouveau seuil de cynisme en taxant les pourboires. Oui, les pourboires. Ces quelques euros glissés pour saluer un bon service. Cette gratification modeste et humaine, née de la reconnaissance, non de la contrainte. Ce complément de revenu bienvenu pour ceux qui travaillent dur, souvent pour des salaires modestes, dans des métiers exigeants et mal considérés.
Il faut n’avoir jamais passé une soirée de service en restauration pour envisager une telle mesure. Il faut n’avoir jamais tenu un plateau, assuré des livraisons ou des heures de route, affronté les heures debout, le stress, les clients difficiles, le rythme éreintant d’un double service pour imaginer ponctionner ce qui relève d’un simple geste de gratitude.
Mais dans les bureaux des technocrates, où l’on s’échange plus facilement des tableaux Excel que des poignées de main, le réel n’existe plus. Pour ces gens-là, tout est flux, tout est traçable, tout est taxable. A leurs yeux, un pourboire n’est pas un merci, c’est une niche fiscale.
Le gouvernement prévoit ainsi de ne pas reconduire, à partir de 2026, l’exonération de charges et d’impôts sur les pourboires instaurée en 2022. Une mesure pourtant saluée par l’ensemble du secteur, et utile pour redonner de l’attractivité à des métiers qui peinent à recruter. Les chiffres sont clairs : 83 % des salariés considèrent le pourboire comme un avantage incontournable. Ils sont 41 % à envisager de quitter leur emploi si ce revenu est taxé. Faut-il vraiment aggraver la pénurie de main-d’œuvre dans la restauration pour quelques miettes fiscales ?
Car cette idée est non seulement injuste, mais économiquement absurde. Son rendement budgétaire sera marginal, voire négatif. Ce ne sont pas grâce aux pièces laissées par les clients qu’on comblera un déficit public annuel de 170 milliards d’euros. Ce n’est pas en prélevant quelques euros sur un sourire qu’on réformera l’Etat. Le coût administratif de cette collecte dépassera probablement son rendement.
Spirale infernale. Voilà la spirale infernale de l’inefficacité coûteuse qui pénalise le mérite. Plus l’État est obèse, plus il a faim. Plus il prend de l’argent, plus il est clochardisé. Plus il échoue, plus il ponctionne. Plus il dysfonctionne, plus il surveille ceux qui tiennent encore par le travail.
Il faut une sacrée déconnexion sociale pour penser que quelques euros de pourboire sont un luxe. Mais surtout, il faut manquer singulièrement de courage politique pour aller chercher là ce que l’on n’ose pas récupérer ailleurs.
Ce système est devenu fou. Il confond la fraude et la reconnaissance, le privilège et la récompense, le travail et la rente, la spoliation et l’impôt. Il surveille le serveur plutôt que le fraudeur. Il prétend taxer la générosité quand il faudrait contrôler la corruption, coûteuse et toxique, conséquence de la confusion que génère l’Etat dans l’économie via sa caste nourrie au capitalisme de connivence, celui des circuits opaques de la dépense publique, des copinages bien placés, des passe-droits protégés. Pendant qu’on traque les euros du serveur, on ferme les yeux sur les millions qui s’évaporent dans les méandres de l’administration.
Inefficacité. Ce projet dit tout d’un système usé, rongé par l’inefficacité, incapable de se réformer mais toujours capable de punir ceux qui travaillent dans l’économie réelle, de l’effort et du risque. Cette mesure consacre l’échec d’une vision purement redistributive de la société : au lieu de créer de la richesse, on organise méthodiquement sa confiscation.
On ne demande pas au gouvernement de féliciter les serveurs, chauffeurs, pompistes, coiffeurs ou autres livreurs. On lui demande simplement de ne pas les pénaliser. De ne pas humilier des professionnels par une mesure mesquine et contre-productive.
Liberté. Le pourboire, c’est le dernier espace de liberté dans la relation de service. Un client satisfait gratifie directement celui qui l’a bien servi. Sans intermédiaire. Sans bureaucratie. Sans Etat. C’est précisément ce qui dérange. Cette zone libre de générosité insupportable au Léviathan fiscal. Cette transaction humaine qui échappe à la machine administrative.
Refusons cet Etat soupçonneux et tatillon. Un Etat qui ne croit plus en l’initiative, qui traque ce qui échappe à ses radars, qui taxe ce qu’il ne comprend pas. Un Etat qui étouffe les élans simples – l’effort, le mérite, la générosité – sous prétexte d’équité.
Faudra-t-il demain déclarer les quelques pièces données à une personne nécessiteuse ? Jusqu’où ira cette folie bureaucratique ?
A force de tout vouloir encadrer, cet Etat détruit ce qu’aucune loi ne peut décréter : les ressorts moraux qui tiennent une nation debout – la décence, la reconnaissance, la solidarité librement consentie. Ce ne sont pas des variables fiscales. Ce sont les conditions élémentaires du lien social qu’il nous appartient de reconstruire par le sens de la justice et de la mesure.
Réhabilitons l’effort, allégeons les charges, retrouvons du bon sens fiscal : tout commence par le respect de ceux qui, chaque jour, accomplissent leur part, honnêtement, avec dignité.
Tout comme on ne rétablira pas les comptes publics en faisant les poches des Français, on ne redressera pas le pays en surveillant les pourboires pendant qu’on ferme les yeux sur la fraude et la corruption. On le redressera en ayant le courage de réformer l’Etat, de libérer le travail, de valoriser le mérite. En rendant à chacun ce qui lui appartient : au serveur son pourboire, au citoyen sa liberté, à l’Etat ses vraies missions. Ainsi va la France…
David Lisnard en Corse : « Je ne cherche pas à plaire, je cherche à convaincre »
En déplacement en Corse, David Lisnard, président de Nouvelle Énergie, s’est exprimé dans l’émission PuliticaMente sur RCFM.

Autonomie : une illusion institutionnelle ?
Favorable à la décentralisation, David Lisnard met en garde contre « une illusion institutionnelle » :
« En Corse, on parle surtout de transports, de logement, du coût de la vie… Pas seulement d’autonomie. Quand vous perdez tous les matchs de foot, il y a ceux qui essaient d’améliorer l’équipe, et ceux qui veulent changer les règles. »
Reconnaissance d’un État de Palestine : « une faute lourde »
Il critique également la décision d’Emmanuel Macron à l’ONU, qualifiée de « faute lourde ».
Taxe Zucman : « une illusion dangereuse »
Concernant la proposition de taxe sur les grandes fortunes, il tranche :
« Cette taxe, c’est une illusion dangereuse. Elle ne résoudra rien. Si on empêche les entrepreneurs de développer leurs entreprises ici, ils iront ailleurs. »
« Convaincre, pas plaire »
« Moi je ne cherche pas à plaire, je cherche à convaincre. »
Avec Nouvelle Énergie, David Lisnard défend une ligne claire : réduire la dépense publique, libérer l’innovation et refuser les illusions fiscales qui aggravent les problèmes.
Retrouvez le replay de son interview sur le site de France Bleu RCFM en cliquant ici.